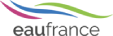La BDLISA apporte une source d'information sur les eaux souterraines adaptée à de multiples applications pour les organismes publiques en appui aux politiques publiques sur l'eau ou les bureaux d'études dans leur différents types de travaux.
Des applications en appui aux politiques publiques sur l'eau
En fournissant un cadre scientifique dans les contours et les caractéristiques des entités hydrogéologiques, la BDLISA apporte une source d'information incontournable dans les projets d'appui aux politiques publiques sur l'eau.
Les rapports d'expertises
L'inondation par remontée de nappe est un phénomène qui se produit lorsque le niveau de la nappe souterraine libre dépasse les niveaux maxima annuels habituels et déborde au-dessus du sol. Dans le cadre de ces missions de service public, les directions régionales du BRGM peuvent être sollicitées par les préfets pour conduire des rapports d'expertises dans les cas d'inondations liées à la remontée de nappe. Dans ce contexte, la BDLISA fournit des éléments hydrogéologiques pour aider les experts à identifier les causes de l'inondation. A titre d'exemple, les inondations observées à Plouguerneau et à Naizin ont été diagnostiquées avec l'aide du référentiel (Crastes de Paulet, 2014; Neveux, 2014).
## Vulnérabilité et risque des eaux souterraines
La BDLISA est également employée dans le cadre de Schémas Directeurs d'Aménagement et Gestion de l'Eau (SDAGE). En Loire-Bretagne, une disposition du SDAGE définit des nappes à réserver à l'alimentation en eau potable. Une amélioration des contours de ces nappes a pu être réalisée pour fournir une cartographie plus précise et répondre aux besoins des services de l'état. La réalisation de cette cartographie s'est basée sur les contours des entités hydrogéologiques de la BDLISA (Salquèbre, 2013). Cette même méthode a été mise en place dans le cadre du SDAGE de Seine-Normandie pour délimiter les ressources en eau stratégiques (Bel, 2015).
Dans un contexte similaire, la BDLISA a été utilisée pour la caractérisation fine de la vulnérabilité des captages en eau potable en région Aquitaine (Mazurier et al., 2012) et la cartographie du risque des aquifères côtiers à l'intrusion marine (Dörfliger et al., 2011).
## Une aide dans les objectifs fixés par la Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE)
La DCE adoptée en 2000 vise à établir une politique communautaire cohérente dans le domaine de l'eau. Son objectif est d'atteindre un bon état des différents milieux aquatiques sur tout le territoire européen. Sa mise en œuvre est itérative de façon à tenir compte des progrès réalisés et des nouvelles connaissances acquises.
Les Masses d'Eau Souterraines (MESO) constituent les unités de gestion sur lesquelles s'appliquent toutes les dispositions de la DCE en matière de gestion quantitative et qualitative des eaux souterraines. Leur découpage réalisé initialement en 2004 a été mené sur la base d'un nombre prédéfini de masses d'eau et du premier référentiel hydrogéologique français, la BDRHF (Chadourne, 2003). Aujourd'hui, les nouvelles versions de ces MESO s'appuient en grande partie sur les dernières évolutions de la BDLISA. Le guide méthodologique publié en 2013 par Brugeron and Schomburgk (2013) présente ces recommandations.
## La prospection géothermique
Dans un contexte d'envolée des prix de l'énergie et une nécessité de réduire l'empreinte écologique des activités humaines, le recours aux énergies vertes offre une alternative intéressante, particulièrement lorsque celles-ci présentent un caractère local et que leur viabilité économique est prouvée. Les entités hydrogéologiques de la BDLISA sont utilisées dans de nombreux projets de prospections géothermique pour identifier, caractériser et modéliser le potentiel géothermique des aquifères d'une région (Durst et al., 2011; Maton et al., 2012; Poux et al., 2012).
# Une source d'information à destination des professionnels et des scientifiques
La BDLISA est également une source d'information pour les bureaux d'études et les organismes scientifiques tels que le CNRS et les universités. En tant que référentiel, il est généralement utilisé pour décrire le contexte hydrogéologique d'une zone d'étude. C'est le cas, par exemple, pour une étude d'impact sur l'extension d'une carrière (Geoscop, 2014) ou un avis d'expert sur l'extension d'un cimetière (Galia, 2014). Ce type d'utilisation se retrouve dans le cadre de travaux de recherches en lien avec l'eau et le changement climatique (Fock, 2013; Bouroullec et al., 2014; Magand, 2014), la compréhension des écoulements dans une aire d'alimentation (Gourcy et al., 2014) ou encore la quantification de la contribution des eaux souterraines sur les débits de la Loire (Lalot et al., 2015).
Des applications pratiques émergent également grâce aux données de la BDLISA. Par exemple, l'utilisation des mâchefers en technique routière est encadrée par une réglementation qui impose d'exclure certaines zones pour des raisons environnementales (en dehors des zones inondables, en dehors des périmètres de protection rapprochés des captages d'alimentation en eau potable, proches de karst affleurant ...). Un bureau d'étude a donc mis en place un service cartographique en ligne pour aider les exploitants de mâchefers d'incinération. Ce service s'appuie sur la BDLISA pour afficher les zones d'exclusion liées à l'utilisation de ces mâchefers.
# Informer, sensibiliser, aider
## De la diffusion aux outils d'aide à la décision
La diffusion d'informations fiables, actualisées et interopérables sur les eaux souterraines est un levier majeur pour sensibiliser les citoyens à la préservation des ressources en eau et faciliter le travail des professionnels. La diffusion de la BDLISA s'inscrit dans cette démarche. Elle se base sur la mise en place d'une architecture informatique permettant de développer des services-web cartographiques. L'information devient accessible à tous et facilement exploitable grâce aux applications web. C'est le cas de ce site web qui propose plusieurs services pour visualiser les entités hydrogéologiques de la BDLISA et obtenir des informations complémentaires pratiques comme la fiche synthétique et le log hydrogéologique en un point donné.
D'autres plateformes peuvent aussi se "brancher" sur la BDLISA pour développer leurs propres outils d'aide à la décision. Par exemple, les Systèmes d'Information pour la Gestion des Eaux Souterraines (SIGES) du Centre-Val de Loire, de Seine-Normandie et d'Aquitaine proposent un module de log « géo-hydrogéologique », associant les entités BDLISA avec les résultats de modèles hydrogéologiques. Ce type d'application permet par exemple aux bureaux d'études d'identifier l'épaisseur et la profondeur des nappes au droit d'un site avant la réalisation d'un forage.
Nouvelle carte hydrogéologique de la France
Les données de la BDLISA permettent la construction de cartes thématiques. La première carte hydrogéologique à l'échelle de la France datant de 1978, le BRGM a lancé en 2014 la création d'une deuxième version sur la base de la version v0 de la BDLISA. En s'appuyant sur cette version, la carte gagne en résolution, passant du 1/1 500 000 au 1/1 000 000.
Il est prévu de réaliser une seconde carte synthétique, toujours sur la base de la BDLISA, des ressources en eau souterraines du territoire. Cette carte permettra notamment de localiser les formations géologiques exploitées ou susceptibles de l'être pour l'alimentation en eau potable, l'irrigation ou l'industrie et d'y intégrer des notions de volumes.